|
Une équipe d'astrophysiciens européens à laquelle ont participé des
laboratoires du CNRS (INSU) et du CEA (Dapnia/SAp)
[1] vient de découvrir, en
collaboration avec des collègues japonais et chinois, une des plus
étranges explosions d'étoiles jamais observées Cette explosion est
survenue le 9 octobre 2006 dans une galaxie lointaine située à plus
de 80 millions d'années-lumière et a été suivie pendant plus de
soixante jours par huit télescopes différents en Europe, Chine et
Japon. Les observations ont montré que l'astre qui s'est désintégré
était une étoile massive, de 15 à 25 fois la masse du Soleil, sans
doute constituée uniquement de carbone et d'oxygène. Ce
cataclysme rare a été précédé tout juste deux ans auparavant par un
bref flash lumineux. Ce signal avant-coureur, dont la signification
vient seulement d'être comprise, permettrait aux astronomes, s'il
s'avère être une règle générale, de repérer les étoiles se
trouvant aux tous derniers instants de leur existence et peut-être
même de "prédire" les explosions.
Ces résultats sont
publiés dans la revue
Nature
du 14 juin 2007.
Mort d'une étoile en direct
La découverte a été le fruit d'une
étroite
collaboration entre astronomes professionnels et amateurs. Tout a
commencé le 14 octobre 2004 quand l'astronome amateur
japonais Koichi Itagaki, grâce à un petit
télescope de 60 cm de diamètre, détecta un
objet dans la galaxie UGC4904
(dans la constellation du Lynx) dont la brillance avait
considérablement augmenté. Au début, il crut
assister
à l'explosion d'une "supernova",
phénomène lumineux qui accompagne l'effondrement
d'une étoile en fin de vie ; mais au lieu de
s'amplifier rapidement puis de décroitre lentement comme le font
les
Supernovae, l'objet disparut à
nouveau au bout de quelques jours seulement.
L'événement
fut donc catalogué comme un flash lumineux transitoire,
phénomène parfois observé pour des
étoiles massives très bleues ou LBV (pour
Luminous Blue Variables).
Photographie de la galaxie UGC4904 à trois
époques différentes. En octobre 2004, un objet lumineux fait son
apparition dans la partie extérieure à peine visible de la galaxie
durant quelques jours puis disparait. En septembre 2006, il est
toujours absent. Le 9 octobre 2006, il devient aussi lumineux que le
centre de la galaxie, émettant plus de lumière qu'un milliards
d'étoiles. La supernova, baptisée SN2006jc, atteindra une magnitude
apparente maximale de 14 avant de lentement décroitre. Sur l'image
du 29 octobre, elle est encore de 15.65. Il s'agit d'un cas unique
d'une explosion d'étoile précédée par un flash lumineux deux ans
auparavant.
Cliquer pour agrandir
Deux ans
après, le 9
octobre 2006, à exactement 18h03 Temps Universel,
l'astronome japonais signale
au même endroit une nouvelle
apparition mais cette fois-ci l'objet est plusieurs dizaines de fois
plus
lumineux. Un consortium européen travaillant sur les Supernovae
est
alors averti et une batterie de télescopes
[2] est
mobilisée, dans un effort collectif dirigé par
Andrea Pastorello du
Centre d'Astrophysique de
l'université de Belfast (UK).
Les
premières observations, obtenues à
l'Observatoire
de La Palma
(Espagne), révèlent une explosion
particulière. En effet dans le spectre (la répartition
de
la
lumière en fonction de
la longueur d'onde) de l'objet, il n'y a aucune trace
d'hydrogène ou
d'hélium, les
éléments les plus abondants dans les
enveloppes des étoiles. Il faut donc suivre l'évolution
de cet
objet au plus près. Le télescope de 193cm de l'Observatoire de Haute-Provence (celui-là même qui avait découvert la première
planète extra-solaire en
1995) entre en branle, sous l'impulsion de Michel Dennefeld (IAP-CNRS) qui coordonne la partie
française de la collaboration. Les télescopes ne sont
évidemment pas
inactifs, étant attribués de longs mois à
l'avance à divers
observateurs pour des programmes très variés : on applique
donc la
procédure habituelle en cas d'urgence, et l'observateur
présent au
télescope pour un tout autre programme est sollicité pour
collaborer.
C'est ainsi que Jean-Marc Bonnet-Bidaud (CEA-Saclay) est amené
à prendre son premier spectre de Supernova et s'enthousiasme pour ses
particularités. Les observations se poursuivent, nuit
après nuit,
la panoplie de télescopes mobilisés permettant de
surmonter les
inévitables aléas de la météo. Et oh
surprise, au bout d'une dizaine de
jours, apparaissent enfin
les
premières traces d'hélium dans le spectre de la
Supernova !
Un cœur massif...
Des observations sur près de trois mois
vont permettre de comprendre ces particularités.
La supernova baptisée SN2006jc (d'après son
numéro d'ordre de découverte dans
l'année [3]),
a atteint une luminosité maximale
caractéristique des plus
fortes explosions d'étoiles, plus d'un
milliard de fois celle du Soleil. Les astronomes avaient l'habitude de
classer ces explosions en deux grandes catégories : les
supernovae de type I ou de type II, correspondant à deux
types d'observations (et de phénomènes) totalement différents. Les
types I, caractérisées par de fortes raies de
silicium et pas
d'hydrogène dans le spectre de l'explosion, signalent la
désintégration d'une petite
étoile compacte, une naine blanche, rendue instable par une
accumulation de matière venant d'un compagnon. Les types II,
où
l'hydrogène et l'hélium dominent, marquent au contraire l'explosion d'une étoile massive. SN2006jc
ne correspond à aucune de ces catégories : elle a
été cataloguée dans une catégorie intermédiaire, les Ib/Ic.
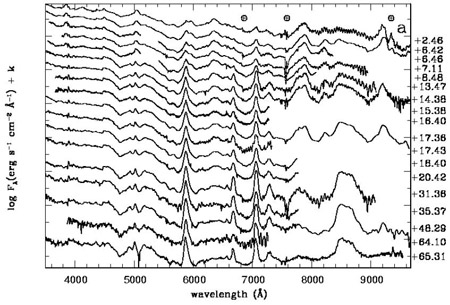
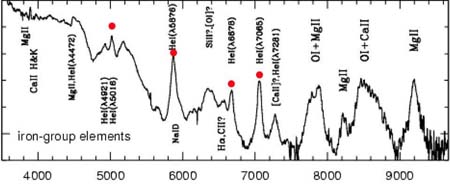
L'évolution du spectre de la supernova SN2006jc. L'échelle
à droite
indique la date après l'explosion (en jours). La répartition de la
lumière en fonction de la longueur d'onde (ici en
angströms)
montre l'absence totale d'hydrogène. Seules quelques raies
"étroites" d'hélium apparaissent au bout d'une dizaine de
jours. Toutes
les autres raies identifiées sont celles
d'éléments chimiques
"évolués"
(oxygène, magnésium, ...), provenant du cœur de
l'étoile. Le spectre du bas donne l'identification de quelques raies et
les raies étroites de l'hélium sont indiquées par des points rouges.
Ces cas très rares
ont
été découverts très
récemment : leur rareté est sans doute due
à la masse élevée de
l'étoile, probablement une
étoile de 60 à 100 masses solaires qui a perdu
une grande
quantité de masse auparavant. Le spectre observé est
alors
dominé par les éléments qui se trouvent dans son cœur, typiquement un
cœur de carbone et d'oxygène de 15 à 25 masses
solaires.
Si l'étoile n'a perdu que son enveloppe d'hydrogène au
cours de sa vie,
on observera encore des raies
d'hélium dans le spectre de l'explosion : la SN est
classée Ib.
Mais si elle a perdu et son enveloppe d'hydrogène, et son
enveloppe
d'hélium (ce qui est d'ailleurs la caractéristique des
étoiles de
Wolf-Rayet !), elle sera classée Ic. A noter que si la
classification est ici purement observationnelle (la
catégorie I
signifiant simplement l'absence d'hydrogène dans le spectre), du
point de vue de
la physique des objets, les types Ib/Ic sont de même nature que
les
type II ; les supernovae de type I "originales" sont maintenant
appelées Ia, pour bien faire la distinction entre les phénomènes.
Mais alors, d'où vient l'hélium observé au bout
d'une dizaine de jours ?
Une observation cruciale donne ici la réponse : lorsque
l'hélium est
observé dans les spectres de Supernovae, on constate en
général de très grandes
vitesses d'éjection (quelques dizaines de milliers de
kilomètres par
seconde), et les raies sont alors larges. Or, ici, les raies
d'hélium
observées sont étroites ! L'explication est alors limpide :
on sait que
les enveloppes d'étoiles sont éjectées à
faible vitesse lorsque ce
phénomène apparait au cours de leur vie, et elles
s'éloignent donc
lentement de leur étoile... Ici, l'onde de choc de l'explosion a
"rattrapé" au bout de quelques jours l'enveloppe
éjectée précédemment
et l'a "illuminée", donnant l'illusion d'un type Ib... Mais il
est clair qu'il s'agit bien de l'explosion d'une étoile massive, et l'on
voit
l'importance de l'observation suivie de ces objets pour une bonne
compréhension des mécanismes d'évolution et
d'explosion finale.
Signal d'alarme
Reste encore à comprendre le signal d'alarme envoyé deux
ans auparavant. Un peu comme pour
les tremblements de terre, les scientifiques connaissent
très peu d'événements avant-coureurs
capables de leur indiquer l'imminence d'une explosion
d'étoile. Depuis quelques années, on a
découvert que certaines étoiles massives
émettaient une brève et puissante
impulsion de rayons gamma, les célèbres "sursauts
gamma" mais ce très bref éclair intervient au
début même de l'explosion, laissant trop
peu de
temps aux astronomes pour se préparer.
Dans le cas de SN2006jc, la première augmentation
lumineuse
est intervenue deux ans plus tôt et semble identique
à ce
qui
est observé autour des LBV (Luminous Blue Variables),
ces étoiles
bleues
très massives, mais qui possèdent encore toute
leur
enveloppe d'hydrogène et d'hélium. A-t-on
assisté
alors à un dernier épisode de perte de masse qui
a brutalement
dépouillé une LBV de son enveloppe ? Aucune
théorie d'évolution ne semble l'autoriser en un
temps si
court. Il pourrait s'agir également d'une convulsion du
cœur même
de
l'étoile, un phénomène jamais
observé auparavant. Les chercheurs considèrent une
autre alternative possible: l'étoile pourrait être un
couple,
l'une aurait explosé tandis que la seconde serait une LBV
responsable du flash. Pour l'instant, ils espèrent pouvoir
bientôt
utiliser le télescope spatial Hubble pour rechercher cette
deuxième étoile qui aurait
alors survécu.
Ces
observations ont mis en
lumière l'efficacité de la
collaboration entre amateurs et professionnels et l'importance des
télescopes de petite et moyenne dimensions, plus facilement
disponibles et qui peuvent être mobilisés
rapidement et pendant des périodes continues. Ils pourraient en
particulier servir à surveiller
les candidats à la mort violente...
La supernova SN2006jc ouvre en effet des horizons nouveaux pour
prédire
les explosions d'étoiles massives. Jusqu'ici, il
était
impossible de déterminer l'imminence d'une explosion, mais si le
scénario décrit ci-dessus se confirme, les flashs
précurseurs seraient un signal précieux. Reste encore
à savoir si plusieurs convulsions (et flashs) ont lieu avant
l'explosion finale, ou si un seul événement
précède l'issue fatale. Une des LBV
proches
est l'étoile Eta-Carina qui est
célèbre pour son augmentation de
luminosité à la fin du 19e siècle :
l'événement de 1843 en a fait la deuxième
étoile la plus brillante du
ciel d'alors ! Aujourd'hui elle est redevenue invisible à
l'œil nu. Un
prochain sursaut lumineux pourrait annoncer son explosion imminente et définitive.
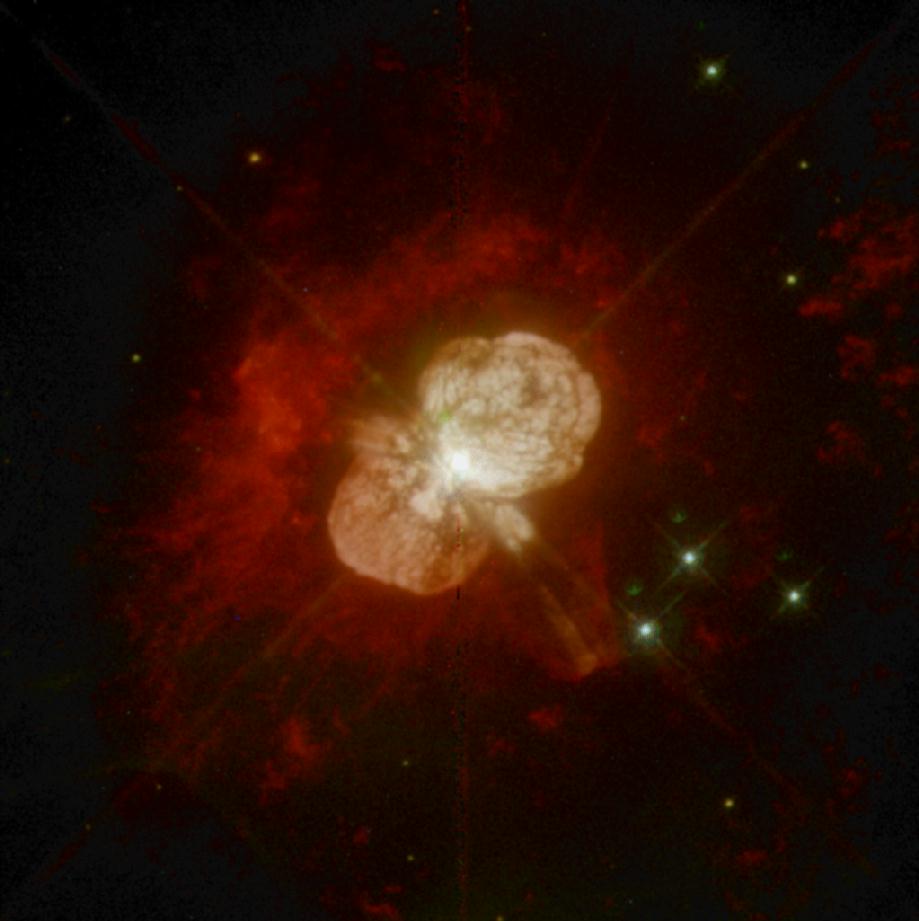
L'étoile Eta-Carina, photographiée ici par le Télescope Spatial
Hubble pourrait être un exemple proche similaire à SN2006jc. Située
à environ 8 000 années-lumière, l'étoile est très massive, sans
doute plus de 100 fois la masse du Soleil, peut être double et sans
doute très proche d'une explosion imminente.
Crédits NASA/Hubble
Michel Dennefeld et Jean-Marc Bonnet-Bidaud
Publication :
"A giant outburst two years before the core-collapse of a massive star"
A.
Pastorello, S. J. Smartt, S. Mattila, J. J. Eldridge, D. Young, K.
Itagaki, H. Yamaoka, H. Navasardyan, S. Valenti, F. Patat, I.
Agnoletto, T. Augusteijn, S. Benetti, E. Cappellaro, T. Boles, J.-M.
Bonnet-Bidaud, M.T. Botticella, F. Bufano, C. Cao, J.
Deng, M.
Dennefeld, N. Elias-Rosa, A. Harutyunyan, F. P. Keenan, T. Iijima, V.
Lorenzi, P. A. Mazzali, X. Meng, S. Nakano, T.B. Nielsen, J. V. Smoker,
V. Stanishev, M. Turatto, D. Xu, L. Zampieri
Publié dans la revue Nature du 14 juin2007,
pour une version électronique, voir astro-ph/0703663.
Voir les communiqués de presse du
CNRS et
du
CEA
(13 juin 2007).
Notes
:
[1] Collaboration française
:
Institut
d'Astrophysique de Paris (CNRS/UMR7095),
Observatoire
de Haute-Provence (CNRS/USR2207).
Service
d'Astrophysique du CEA/Dapnia
(CNRS/UMR 7158),
[2] Observations
: Les
observations ont été obtenues à
l'Observatoire
de Haute-Provence (Télescope 1.93m, CNRS, France),
l'Observatoire d'Asiago (Telescope Copernic 1,82m, Italie),
l'Observatoire Astronomique National de Chine (Télescope 2.16m,
BAO,
Xinlong Observatory, Chine)
et l'Observatoire de La Palma (Telescopio Nationale Galileo 3.58m,
Nordic Optical Telescope 2.56m, Liverpool Telescope 2.0m et William
Herchell Telescope 4.2m, Canaries, Espagne).
[3] Supernova.
Plusieurs centaines de supernovae sont découvertes chaque
année. Le nom
de la supernova correspond à l'année de sa
découverte suivie de lettres
indiquant son rang dans l'année. "SN2007a" est la
première supernova
découverte en
2007 et "SN2007aa" la 27e. SN2006jc est donc la 263e supernova
découverte en 2006.
|